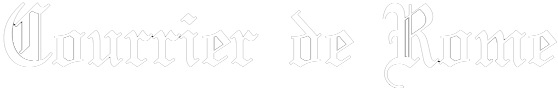Anniversaire d’une dégringolade : il y a trente ans, Dom Gérard concélébrait la nouvelle messe
Publié dans le N°685 de la publication papier du Courrier de Rome
« Il y a quelque chose de pire que le reniement déclaré, c'est l'abandon souriant des principes, le lent glissement avec des airs de fidélité. » Dom Gérard.
Le jeudi 27 avril 1995, Dom Gérard Calvet, premier Abbé du monastère Sainte-Marie Madeleine du Barroux, concélébrait la nouvelle messe avec le pape Jean-Paul II. C’était il y a trente ans. La revue Fideliter s’en faisait l’écho, publiant le cliché en noir et blanc dans un article de l’abbé Michel Beaumont, et le reproduisant en couleurs dans la page de quatrième de couverture. Celui qui avait dénoncé, dix ans plus tôt, la « félonie » de Dom Augustin pour avoir rompu avec Mgr Lefebvre et adopté le nouveau rite de la messe, se retrouvait dans une situation finalement assez semblable.
Tristement intitulé « La dégringolade de Dom Gérard », l’article de l’abbé Beaumont pointait du doigt les signes avant-coureurs d’un événement qui se fit « dans la plus grande discrétion ». Parmi ces signes : l’acceptation et même la défense du concile Vatican II dans son intégralité ; l’acceptation et même la défense du nouveau Catéchisme de l’Eglise catholique récemment promulgué.
Il était loin le temps où, au lendemain de son acceptation des propositions romaines, à l’été 1988, Dom Gérard assurait qu’il avait signé un accord « sans que nulle contrepartie doctrinale ou liturgique ne soit exigée ».
Dom Gérard sans concession
Lorsque le prieur du monastère Sainte-Marie-Madeleine du Barroux se décida à officialiser son accord avec les autorités conciliaires, ce fut le journal Présent que dirigeait Jean Madiran qui se chargea de le rendre public. L’édition du 18 août 1988 publiait la lettre du cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, ainsi qu’une déclaration de Dom Gérard.
La lettre du cardinal Ratzinger, datée du 25 juillet, co-signée par le cardinal Mayer en tant que président de la Commission pontificale Ecclesia Dei, faisait connaître la décision du pape Jean-Paul II de relever les moines ayant reçu des ordres sacrés de Mgr Lefebvre « de toutes les censures et irrégularités encourues », et d’accorder aux monastères du Barroux et de Nova Friburgo « la pleine réconciliation avec le Siège apostolique, aux conditions déjà offertes par le cardinal Paul Augustin Mayer lors de sa visite au monastère du Barroux le 21 juin 1988 ». Parmi ces conditions : l’usage des livres liturgiques de 1962, et la possibilité 1) de recourir à un évêque pour conférer les ordres en suivant le Pontifical de 1962 ; 2) aux fidèles d’y recevoir les sacrements et 3) aux moines de continuer leur apostolat et de développer leurs différents ministères. Est également prévue l’insertion des moines de Dom Gérard dans la Confédération bénédictine.
La déclaration de Dom Gérard expliquait pourquoi celui-ci avait accepté le protocole d’accord que Mgr Lefebvre avait refusé le 6 mai précédent : « Ce que nous demandions depuis le début (messe de saint Pie V, catéchisme, sacrements, le tout conforme au rite de la Tradition séculaire de l’Eglise), nous était octroyé, sans contrepartie doctrinale, sans concession, sans reniement ».
Dom Gérard ajoutait quelles avaient été les raisons qui l’avaient guidé : faire partie de l’Eglise visible ; rendre à l’ordre bénédictin l’apanage de sa tradition liturgique ; s’accorder avec les lois de l’Eglise du moment que la foi et les sacrements étaient saufs ; enfin, et surtout, être missionnaire.
Ne l’était-il pourtant pas déjà, et dans l’Eglise visible ? Par « missionnaire », Dom Gérard entendait en fait, comme il l’expliquera bientôt, changer de « style de combat », quitter « le ronron d’une prédication acceptée depuis des années par un auditoire accoutumé » (merci pour lui) pour « abaisser le pont-levis » et ne pas rester dans « un château-fort imprenable ». Dans sa déclaration du 18 août, Dom Gérard dit simplement : « la tradition n’est pas un camp retranché, hérissé de défenses, mais un organe de diffusion ». Cette leçon d’esprit missionnaire à ceux qui luttaient depuis deux décennies pour maintenir la vie chrétienne face à l’effondrement général du catholicisme parut un peu forte à plus d’un.
A la signature de l’accord, Dom Gérard avait posé deux conditions : 1) « Que cet événement ne soit pas un discrédit porté sur la personne de Mgr Lefebvre (…) n’est-ce pas grâce à la ténacité de Mgr Lefebvre que ce statut nous est octroyé ? » ; 2) « Que nulle contrepartie doctrinale ou liturgique ne soit exigée de nous et que nul silence ne soit imposé à notre prédication antimoderniste ».
Avec de telles conditions apparemment obtenues sans concession et une telle protestation de fidélité et de piété envers l’œuvre et la personne de Mgr Lefebvre, il semblait que Dom Gérard offrît toutes les garanties de fidélité au bon combat de la foi contre le modernisme triomphant. Cette paix séparée, préparée en sous-main dès le 19 juin mais qui n’avait pas empêché Dom Gérard de paraître à la cérémonie des sacres à Ecône, le 30 juin, pour y jouer, selon ses termes, la fin d’une « comédie », ne devait pas, ne pouvait pas être une trahison.
C’est dans ce sens que, dix jours après la parution de sa Déclaration, Dom Gérard s’exprimait publiquement sur l’accord qu’il venait de signer et les perspectives d’avenir de sa communauté.
Dom Gérard persiste et signe
Dans un entretien téléphonique à Radio Courtoisie, le dimanche 28 août 1988, il revenait auprès des auditeurs sur la première condition qu’il avait posée. Elle correspondait, disait-il, au « cri unanime » de toute la communauté : « nous ne voulons pas que ce que nous faisons soit un discrédit porté sur la personne et l'œuvre de Mgr Lefebvre : (…) il reste notre modèle, le grand défenseur de la foi, celui qui a œuvré pour développer le sacerdoce, pour développer la vie paroissiale, le sacramentalisme [sic], les catéchismes… »
En effet, tous les prêtres de la communauté, sans exception, avaient été ordonnés par l’archevêque à Ecône. Non seulement un solide devoir de piété et de gratitude les liait à Mgr Lefebvre, mais encore l’histoire même du monastère, depuis ses débuts à Bédoin jusqu’à son installation au Barroux, les portait à se considérer comme ses fils.
Ainsi Dom Gérard avait-il pu écrire, moins d’un an plus tôt, depuis le Brésil où il venait de fonder un monastère : « je serai le 3 octobre [à Ecône] avec nos confrères de la Fraternité Saint-Pie X pour vous dire la prière et l’affection de vos fils moines. Cher Monseigneur, veuillez nous bénir. Il y a maintenant trois monastères qui vous sont redevables : le Barroux, Santa Cruz et La Font de Pertus qui vit de la retraite que vous leur avez prêchée ».
Sur les ondes de Radio Courtoisie, Dom Gérard insista aussi sur la deuxième condition, ou plutôt « la deuxième exigence », qui avait été « de garder la doctrine et les sacrements. [Cela] comprend tout le dépôt, le dépôt révélé, le patrimoine catholique dans sa pureté, dans sa richesse, et tout est enfermé dans la foi et la doctrine, l'enseignement de la doctrine d'une part, et les sacrements [d’autre part] ». Et Dom Gérard ajoutait avoir bien précisé au cardinal Mayer , le cardinal envoyé par le cardinal Ratzinger le 20 juin 1988 pour prendre langue avec les moines du Barroux et leur proposer un accord, que « nous gardons absolument notre droit de critiquer ce qui n’est pas bon dans certains schémas du Concile, ce qui n’est pas bon dans le gouvernement de certains évêques, et nous gardons le droit, évidemment, de garder tous nos rites liturgiques dans leur pureté ».
Enfonçant le clou, Dom Gérard n’hésitait pas à affirmer que les « nouveaux rites sont naturalistes, sont sociologiques, sont modernistes, et nous [les] refusons... ». En effet, continuait-il, « le grand mal aujourd'hui, c'est le modernisme, c'est-à-dire cette hérésie qui conserve les formules en les vidant de leur substance surnaturelle. » Au passage, il égratignait le cardinal-archevêque de Paris, Mgr Lustiger qui se disait « à la fois juif et chrétien » et était dans l’Eglise, pour expliquer que les authentiques défenseurs de la foi ne sauraient demeurer en marge ou excommuniés, et ne pas être, eux, dans l’Eglise. De même, avec une certaine liberté de parole, il dénonçait, pour illustrer le sentiment religieux dévoyé, « l'illuminisme sodomistique des charismatiques » (sic).
Ainsi donc, à l’été 1988, il n’y avait pas « l’ombre, évidemment, d’une concession cachée. Tout est bien net. Au contraire, ce que nous demandons, c'est bien ce que nous avons reçu. Sans aucune concession ». L’entretien radiophonique s’achevait par un dernier mot : « Vive le Christ-Roi ! ».
Retour au réel
Les assurances et les affirmations renouvelées de fermeté doctrinale et de fidélité à Mgr Lefebvre allaient faire long feu.
Car Dom Gérard semblait oublier un peu vite les motifs qui avaient poussé Jean-Paul II à accueillir tous ceux qui ne voulaient pas suivre Mgr Lefebvre après les sacres épiscopaux sans mandat pontifical. Ce que ce dernier considérait comme « l’opération survie de la Tradition » face à l’aggravation dramatique de la crise de l’Eglise (réunion interreligieuse d’Assise et justification de la fausse liberté religieuse), le pape y voyait une désobéissance constitutive d’un « véritable refus de la primauté de l’évêque de Rome », et donc « un acte schismatique ».
C’était ignorer que, bien loin de vouloir se constituer en Eglise parallèle ou d’usurper le pouvoir de juridiction, Mgr Lefebvre se bornait, pour le bien des âmes qui est la loi suprême dans l’Eglise, à transmettre le pouvoir d’ordre afin d’assurer la continuation du sacerdoce catholique et la validité des sacrements authentiquement porteurs de grâce, spécialement les ordinations et la confirmation. Ce que Dom Gérard savait pertinemment, ayant lui-même publiquement défendu la légitimité des sacres l’année précédente et assuré Mgr Lefebvre en de multiples occasions de son soutien indéfectible et de sa fidélité sans faille.
Or, dans le motu proprio du 2 juillet 1988, le pape Jean-Paul II avait écrit que « l'ampleur et la profondeur des enseignements du concile Vatican II requièrent un effort renouvelé d'approfondissement qui permettra de mettre en lumière la continuité du Concile avec la Tradition, spécialement sur des points de doctrine qui, peut-être à cause de leur nouveauté, n’ont pas encore été bien compris dans certains secteurs de l'Eglise ». C’était, in nuce, l’herméneutique dans la continuité qu’un jour Benoît XVI appellerait de ses vœux. En clair, tous ceux qui allaient se regrouper au sein de la Commission Ecclesia Dei étaient invités à approfondir le Concile pour en faire apparaître la continuité avec la Tradition, mais certainement pas pour en dénoncer les erreurs, ni pour en critiquer les nouveautés ou en rejeter les réformes qui l’avaient suivi. La fidélité au combat contre le modernisme et pour le Christ-Roi que Dom Gérard avait affichée au mois d’août 1988 ne pouvait pas durer longtemps.
Ce fut d’abord le cardinal Mayer qui se chargea de ramener le moine noir à la réalité de ses engagements. Le 10 septembre 1988, il lui écrivait pour réclamer de sa part : « l'acceptation de la doctrine contenue dans la Constitution dogmatique Lumen gentium (n°25), l'adoption d'une attitude positive d'étude et de communication avec le Siège apostolique pour les questions faisant difficulté, la reconnaissance de la validité du Sacrifice de la messe et des sacrements selon les rites promulgués par les papes Paul VI et Jean-Paul II, ainsi que le respect des lois ecclésiastiques contenues dans le droit canonique de 1983. Il n'est donc pas exact d'écrire, comme l'a publié le journal Présent, que la régularisation de votre situation se serait réalisée sans aucun engagement de votre part. De la même manière, s'il n'y a pas lieu de mettre en question l'affection que vous portez à Mgr Lefebvre, votre fidélité au Saint-Père s'oppose à ce que vous preniez publiquement parti pour le Prélat qui a voulu se séparer de la communion ecclésiale ».
C’était le rappel de la substance du protocole que Mgr Lefebvre avait signé le 5 mai avant de se raviser, avec l’ajout d’une mise en demeure d’avoir à se distancer publiquement du prélat désormais honni. Dom Gérard ne pouvait plus jouer sur les deux tableaux. Tout le monde l’avait compris, à Rome comme à Ecône. Ainsi Mgr Lefebvre dira-t-il à propos de sa rencontre du 13 août avec les moniales bénédictines : « Elles sont venues me voir pour me faire des protestations d’affection… Mais cela ne m’intéresse pas. Ce qui m’intéresse c’est de savoir si elles veulent ou non rester dans la Tradition et la garder. Est-ce qu’elles veulent se soumettre maintenant à une autorité moderniste ? Car c’est de cela qu'il s’agit. S’il le faut, elles doivent se séparer de Dom Gérard pour garder la foi, pour garder la Tradition ».
Quelle que soit son intention de ne « pas faire de peine à Mgr Lefebvre », Dom Gérard commença donc à assumer sa position nouvelle. L’insertion dans la « communion ecclésiale » allait rapidement opérer sa dynamique de neutralisation puis de ralliement complet à l’Eglise conciliaire, loin du combat anti-moderniste affiché à l’origine.
Retournement de bure
Ainsi abandonna-t-il sa dénonciation de la fausse liberté religieuse, avouant s’être trompé en la matière. Il fallait donc oublier ses écrits antérieurs, notamment L’Eglise face aux nations, ouvrage édité en 1979 et dédié à Son Excellence Mgr Lefebvre « combattant de la vraie foi et vengeur des droits sacrés de l’Eglise ». Il y dénonçait « l’erreur de Vatican II », le Concile où il avait fallu « attendre la funeste déclaration “Dignitatis humanæ” du 7 décembre 1965, sur la liberté religieuse, pour entendre un langage en rupture totale avec la notion traditionnelle de liberté religieuse ». Dom Gérard expliquait, citations à l’appui, comment « cette déclaration conciliaire se présente en rupture flagrante avec l'enseignement constant du magistère », spécialement celui des papes Grégoire XVI, Pie IX, Léon XIII et saint Pie X. A partir de 1988, Dom Gérard s’opposera à la diffusion et à la réédition de L’Eglise face aux nations.
L’autre ouvrage qu’il fallut remanier était Demain la Chrétienté, dont il avait achevé la rédaction au printemps 1987. Il y redisait son hostilité à la liberté religieuse de Vatican II. Au chapitre 7 (« La chrétienté en armes »), où il identifie la mission de l’Eglise à l’esprit de croisade, il avait écrit : « La déclaration Dignitatis humanae du 7 décembre 1965 fait entendre un langage en rupture totale avec la notion traditionnelle de liberté religieuse. (…) Cette malheureuse déclaration s’identifie avec la proposition condamnée par Pie IX dans Quanta cura ». Au terme de sa démonstration, il ajoutait : « On voit comment la déclaration sur la liberté religieuse au dernier concile émet non seulement une proposition contraire à l’enseignement constant du magistère concernant la liberté des cultes, mais tend également à provoquer une rupture entre l’Etat et les manifestations de la vie religieuse ».
Dorénavant, à la suite des travaux du Père Basile sur la question, la liberté religieuse du concile Vatican II devenait acceptable et en continuité avec le magistère constant de l’Eglise. Une fois ce retournement accompli (janvier 1989), on put envisager la reconnaissance juridique des monastères. Celui des moines vit ses constitutions approuvées par le Saint-Siège le 16 mars 1989 ; celui des moniales le 28 octobre de la même année.
Dès lors rien ne s’opposait plus à l’érection canonique du monastère Sainte-Madeleine du Barroux en Abbaye bénédictine. Le 2 juin 1989, le cardinal Mayer, président de la Commission Ecclesia Dei, en signait le décret d’érection en même temps que le décret de nomination du premier abbé.
Mitré et crossé
Le 2 juillet 1989, un an jour pour jour après le motu proprio de Jean-Paul II, Ecclesia Dei adflicta, Dom Gérard reçoit donc la bénédiction abbatiale des mains du cardinal Augustin Mayer. Le quotidien Présent en rend compte deux jours plus tard, sous la forme d’un reportage signé Jean-Baptiste Castetis, qui avait assisté à la cérémonie « sur le même banc que Jean Madiran ». Enthousiaste et même lyrique, le journaliste est impressionné par la fière allure du cardinal envoyé par Jean-Paul II. Son port de tête a « quelque chose qui rappelle Pie XII », et « cet impressionnant visage ascétique, chevaleresque et net, une gravure de Dürer » (sic).
Le prélat romain affirme dans son allocution qu’il est là « pour accomplir la volonté de Jean-Paul II de faire respecter la sensibilité des fidèles qui sont particulièrement attachés à la tradition liturgique latine de l’Eglise », et pour parfaire « l’insertion du monastère dans la pleine communion ecclésiale ». Tout est dit.
Vingt-quatre ans après avoir exclu Gérard Calvet de l’ordre bénédictin, Augustin Mayer devenu cardinal et président de la commission Ecclesia Dei, lui remet donc crosse, anneau et mitre. Dom Gérard devient le premier Abbé de Sainte-Madeleine.
La mitre, que reçoit Dom Gérard après la bénédiction finale, doit « le rendre terrible aux adversaires de la vérité » et « assez fort pour les attaquer ». Les ennemis de la vérité catholique n’ont qu’à bien se tenir.
C’est peut-être la raison pour laquelle il commence une série de sermons sur le Credo. Il les veut fermes doctrinalement afin « de clouer le bec à certains détracteurs », dit la Chronique de l’abbaye . Dans son commentaire des premiers mots du Credo, Dom Gérard dénonce « trois erreurs qui s’opposent à la foi » : « le scepticisme », « le sentimentalisme » et « peut-être la plus grave de toutes, c’est le modernisme qui consiste à évacuer le contenu du dogme, à vider la foi de son contenu surnaturel pour le remplacer par des notions humaines, sociologiques ou psychologiques ».
La Chronique ne dit pas si ces sermons du dimanche ont fait trembler « la Rome de tendance néo-moderniste et néo-protestante qui s’est manifestée clairement dans le concile Vatican II et après le concile dans toutes les réformes qui en sont issues ». En tout cas Dom Gérard se rend à Rome pour y être reçu en audience privée par le pape, le vendredi 28 septembre 1990.
La veille, le Père Basile, la tête pensante qui a finalement compris la continuité de la liberté religieuse telle que proclamée dans Dignitatis humanae avec le magistère qui la condamnait, a montré au cardinal Ratzinger une erreur fautive dans la traduction française de ladite déclaration. Une avancée majeure.
Au cours de l’audience, Dom Gérard fit habilement remarquer au Souverain pontife que « le Motu Proprio qui devrait, dans la pratique, avoir force de loi et permettre une large utilisation des rites traditionnels, se trouve très fréquemment soit méconnu, soit écarté, soit rendu inutilisable. » Devant la réticence des évêques à appliquer « avec largesse » les dispositions du pape, Dom Gérard pointait alors le risque, pour certains chrétiens, prêtres, religieux ou laïcs, de « s’abandonner à une solution de rupture » ; autrement dit, rejoindre Mgr Lefebvre !
Dès lors il suggérait « une déclaration du Saint-Siège reconnaissant et favorisant la dignité du rite ancien comme forme du rite romain », ainsi que l’érection d’un vicariat apostolique pour les prêtres et les fidèles qui y étaient attachés. On le voit, Dom Gérard ne manquait pas d’idées pour faire avancer la cause de la messe traditionnelle, non sans se retourner contre ses anciens compagnons d’armes en les brandissant comme des épouvantails.
Pourtant, l’obstacle ne venait pas d’Ecône, mais des évêques des diocèses, peu enclins à favoriser le développement de la messe de saint Pie V. A aucun moment Dom Gérard ne remettait en cause le rôle de la Commission Ecclesia Dei censée pourtant veiller à une « application large et généreuse » des directives du Saint-Siège. Mais il commençait à en mesurer l’inefficacité.
Jean-Paul II remercia Dom Gérard et la communauté en répétant le sens de son motu proprio du 2 juillet 1988 : la reconnaissance de la légitimité de l’attachement à la liturgie de 1962 était une « concession destinée à faciliter la communion ecclésiale des personnes qui se sentent liées à ces formes liturgiques ». La Commission Ecclesia Dei n’avait été instituée que « pour faciliter la réinsertion dans la pleine communion ecclésiale ». La priorité n’était certainement pas d’encourager le développement de la liturgie traditionnelle, mais de détourner les fidèles de la personne et de l’œuvre de Mgr Lefebvre.
En tout cas, Dom Gérard commençait de militer pour l’érection d’un ordinariat pour agir plus librement et s’affranchir des oppositions des évêques et du clergé en général. Cela rejoignait les difficultés apparues au sujet de la « commission romaine » prévue dans le protocole d’accord du 5 mai et dont la composition pour résoudre les contentieux ne pouvait pas satisfaire Mgr Lefebvre. Mais le Père Abbé du Barroux n’était pas disposé à attaquer de front la Commission Ecclesia Dei. Fidèle à sa tactique, il préférait brandir l’épouvantail du prétendu schisme pour tenter d’obtenir davantage.
Deux années passèrent sans grand changement, si ce n’est le remplacement du cardinal Mayer par le cardinal Antonio Innocenti à la tête de la Commission Ecclesia Dei à l’été 1991.
Dom Gérard ne demeura pas inactif. Pugnace, il travaille depuis son monastère à la défense et au développement de la liturgie traditionnelle. Il édite un missel quotidien que préface le cardinal Ratzinger et publie deux ouvrages de Mgr Klaus Gamber, un liturgiste allemand très critique de la réforme de Paul VI et qu’apprécie le cardinal Ratzinger. Il reste donc apparemment ferme sur la question de la messe. En réalité, il verse doucement selon son vœu dans « un autre style de combat ». Ainsi défend-il la coexistence pacifique des deux rites : à l’opposition ferme à la nouvelle messe, rite équivoque et protestantisé, succède la proposition « d’une réforme de la liturgie plus fidèle à ce qu’avait demandé le concile ». Quant à la messe de saint Pie V, il propose de lui appliquer « les termes du concile Vatican II sur la parité de tous les rites (…) selon un statut semblable à celui dont jouissaient dans l’Eglise des rites vénérables tels que le dominicain, le lyonnais et l’ambrosien ».
Mais la crise de l’Eglise se poursuivait malgré les tentatives des conservateurs de rappeler la doctrine et la morale. Le « funeste œcuménisme » de Jean-Paul II que Dom Gérard avait dénoncé naguère charriait de fait un redoutable indifférentisme, encourageant le relativisme et la dissolution de la vraie foi dans une sorte de mondialisme spirituel au service des droits de l’homme. Sur ces sujets et, de manière générale, sur le combat anti-moderniste, Dom Gérard s’abstenait de croiser le fer – sauf à propos des plus progressistes d’entre eux, tels un Mgr Gaillot. Il avait compris qu’il devait opérer maintenant « l’approfondissement » du Concile sous le « magistère vivant » du pape régnant. L’engrenage se poursuivait, inexorable.
Le vrai visage de la Commission Ecclesia Dei adflicta
Le nouveau président de la Commission pontificale Ecclesia Dei, le cardinal Innocenti, flanqué de Mgr Camille Perl qui demeurait secrétaire, n’entendait visiblement guère intervenir pour défendre les fidèles attachés au rite traditionnel face aux ordinaires des lieux.
Exemplaire est sa réponse à M. Hubert Calvet, frère de Dom Gérard, qui le sollicitait pour obtenir de l’archevêché de Bordeaux le maintien de la messe traditionnelle dans la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul de Toctoucau, à Pessac (Gironde), après le décès de son desservant, l’abbé Henri Favard. Dans sa lettre du 12 février 1992, le cardinal lui répondait qu’il revenait à l’archevêque de Bordeaux de donner le successeur de son choix à ce prêtre : « Si Mgr l’Archevêque, comme son prédécesseur, a accepté de laisser M. l’abbé Favard suivre la liturgie de 1962, cette bienveillance ne crée pas un droit ». Et d’enfoncer le clou : « Le motu proprio Ecclesia Dei invite les évêques à tenir compte de la sensibilité propre à certains groupes mais en aucune manière il ne doit être un moyen de rétablir le rite d’avant le concile et d’être un obstacle à la réforme liturgique voulue par Vatican II ». Le président de la Commission pontificale connaissait le sens, l’esprit et la lettre de ce qui avait été concédé.
Il pouvait conclure logiquement que, comme il existait déjà un lieu où l’archevêque autorisait la messe selon le rite de saint Pie V à Bordeaux, on ne pouvait « lui faire reproche de n’avoir pas correspondu au désir du Saint-Père ». Dès lors, en ce qui concerne la paroisse Saint-Vincent-de-Paul de Toctoucau, « il est du devoir de Mgr l’Archevêque de donner aux paroissiens la possibilité de bénéficier de la liturgie de Paul VI qu’est la liturgie officielle de l’Eglise et le signe de la communion de tous les fidèles autour de leur évêque ». Fermez le ban !
Il fallait être aveugle pour ne pas comprendre que Rome n’allait pas se mettre à dos les évêques de France et d’ailleurs pour complaire aux demandes de quelques groupes de catholiques attachés à la liturgie traditionnelle. D’autant que les évêques diocésains n’étaient pas sans savoir que le motu proprio de Jean-Paul II n’entendait nullement remettre en cause la réforme liturgique ni le concile Vatican II. Il suffisait de le lire.
Citons le cas emblématique du cardinal Albert Decourtray, archevêque de Lyon, qui ordonna trois prêtres de la Fraternité Saint-Pierre en l’église Saint-Georges en sa métropole, le 29 juin 1993. Dans un entretien au journal France catholique, il réclamait trois choses : « J’attends des traditionalistes ralliés [sic] qu’ils prolongent leurs efforts de lecture et de compréhension du concile afin qu’ils puissent, eux aussi, se l’approprier. Qu’ils travaillent en particulier la question de la liberté religieuse (sur laquelle les dominicains de Chéméré ont mené une réflexion importante et utile) ou celle du dialogue avec les autres religions. (…) J’aimerais que tous les prêtres de la Fraternité Saint-Pierre aient l’autorisation de célébrer dans les deux rites, celui de Paul VI aussi bien que celui de Pie V et que les séminaristes de la Fraternité soient également préparés à célébrer dans le rite de Paul VI. J’aimerais aussi que les prêtres de la Fraternité acceptent de concélébrer la messe chrismale, une des belles résurrections liturgiques dues au concile ».
Si c’était cela ce que Dom Gérard appelait « le redressement doctrinal et liturgique » du pontificat de Jean-Paul II, il y avait encore une belle marge de progression… Pour l’heure, il préférait se faire le défenseur de nouveau Catéchisme de l’Eglise catholique récemment publié fin 1992 face aux critiques que formulaient la Fraternité Saint-Pie X à son endroit . Dans le même temps, il reprenait sa tactique de diaboliser cette œuvre pour obtenir un plus grand appui de Rome. Les lignes qui suivent ne sont guère à son honneur.
En effet, il écrivit le 6 mai 1993 au cardinal Ratzinger : « Il y a désormais plus de 500 lieux de culte en France qui sont plus ou moins dans la mouvance de la Fraternité Saint-Pie X. On s’aperçoit qu’il s’agit là, non pas d’un phénomène vieillissant, mais d’un kyste qui se forme, s’installe et s’établit pour durer : le schisme se durcit et se structure (prieurés, écoles, université, etc.). Certaines communautés se refusent de faire schisme par attachement au Saint-Siège. Néanmoins, elles se voient refuser le bénéfice du motu proprio Ecclesia Dei par leurs Ordinaires ». Dom Gérard suggérait la venue d’un évêque visiteur apostolique envoyé par le Saint-Siège pour dialoguer à égalité avec les ordinaires des lieux et voir enfin les promesses de Rome appliquées « avec largesse ». Contrairement au protocole d’accord du 5 mai 1988, il n’avait obtenu ni commission romaine, ni évêque défenseur de la Tradition. Les deux lui faisaient cruellement défaut.
Le 28 août 1988, Dom Gérard avait déclaré sur les ondes de Radio Courtoisie : « Nous ne voulons pas que ce que nous faisons soit un discrédit porté sur la personne et l’œuvre de Mgr Lefebvre ». Cinq ans plus tard, on en était loin. Lui-même était le premier à les dénigrer à l’occasion d’une manœuvre somme toute misérable. Bien sûr, il n’obtint rien.
Dans la même veine, Dom Gérard signe en 1994 son « testament pour mon successeur » où il se permet de reprocher à Mgr Lefebvre d’avoir manqué de sens de l’Eglise, du « sensus Ecclesiæ, cet instinct surnaturel qui fait sentir ce qui est conforme à la pensée de l’Eglise ».
Avait-il déjà oublié sa propre déclaration de l’été 1988 : « n’est-ce pas grâce à la ténacité de Mgr Lefebvre que ce statut nous est octroyé ? », sans parler de ses multiples protestations d’affection filiale et de gratitude pour son action ? Injuste et ingrat, Dom Gérard manque hélas à la reconnaissance et à la piété qu’il avait tant de fois affichées.
Dom Gérard monte au créneau
Conjointement à sa lettre de mai 1993 au cardinal Ratzinger, Dom Gérard lançait une pétition en faveur de la messe traditionnelle, histoire de faire connaître « ses revendications liturgiques » en haut lieu. Dans la lettre du monastère du 2 juin, il dénonce « l’inertie » de la Commission Ecclesia Dei face aux sollicitations des fidèles : « il arrive même que celle-ci, loin de favoriser vos demandes – ce qui est pourtant sa fonction propre – les déboute avec un aplomb renversant. Selon le cardinal Innocenti, une armée de canonistes, consultée, aurait déclaré l’impossibilité de parler d’un droit aux anciens rites. Par son Motu proprio, le Saint-Père n’aurait accordé qu’une faveur ». Dom Gérard cite les déclarations d’évêques de France, des Etats-Unis et même d’Irlande, où l’évêque de Kerry rapporte les propos du président de la Commission Ecclesia Dei lui-même : « Le cardinal Innocenti ouvrit la discussion en nous disant qu’il s’agissait d’une Commission temporaire qui travaillait d’elle-même à disparaître ». Dom Gérard ajoute un « sic » entre parenthèses qui en dit long.
Il rappelle la volonté du pape Jean-Paul II d’une application « large et généreuse » d’une faveur ou d’un droit – qu’importe, il laisse « aux experts le soin de trancher la question », écrit-il avec une légèreté déconcertante . Et d’agiter une fois encore l’épouvantail : « Certains d’entre [les fidèles] sont alors tentés de se tourner vers la fondation de Mgr Lefebvre ».
Lui-même a définitivement rompu les ponts avec celui dont la ténacité lui a tant apporté : « Quant à nous, nous ne sommes pas tentés de quitter l’Eglise ». L’expérience de la tradition est pour lui possible « avec la collaboration des évêques qui acceptent de mettre en œuvre les décisions du Saint-Père dans leurs diocèses ». Sauf que ceux-ci n’en veulent pas. Et que la Commission Ecclesia Dei ne sert à rien. Alors ?
Alors Dom Gérard va s’adresser directement au Souverain pontife. Il se veut le porte-parole de tous les fidèles refoulés et lance donc une pétition qu’il entend présenter à Jean-Paul II en octobre. La pétition demande « que tous ceux qui veulent célébrer selon le rite tridentin puissent le faire en toute tranquillité et librement, sans qu'il soit besoin d'obtenir des permissions, des autorisations… »
L’audience ne fut pas accordée comme il l’aurait voulu en octobre. Le cardinal Innocenti refusait d’ailleurs de présenter ladite pétition, sans s’y opposer formellement. Finalement il fallut attendre le printemps 1995. C’était il y a trente ans. Il nous reste à voir comment Dom Gérard, parti pour la Ville éternelle pour recourir à l’autorité du pape en vue d’obtenir une réelle liberté pour la liturgie traditionnelle, se retrouva à devoir concélébrer la nouvelle messe.
Tel est pris qui croyait prendre
Le retard permit à la pétition de recueillir le beau chiffre de 75.000 signatures. Mais pour obtenir audience et que son objet n’apparaisse pas « comme une défiance envers le nouveau rite », Dom Gérard dut au préalable concélébrer la nouvelle messe. Le 27 avril 1995, il prit place près de la table d’autel dans la chapelle privée du pape, revêtu d’une aube et d’une étole pastorale. Quant au résultat de sa démarche auprès du souverain pontife, il fut à peu près nul. La lettre aux Amis du monastère mentionne sobrement : « Dans sa réponse, le Saint-Père nous a encouragés à continuer de nous adresser à nos évêques ».
Cette concélébration de la nouvelle messe fut justifiée de la pire des façons par Dom Gérard, qui s’en expliqua dès le 14 juin devant les moniales bénédictines d’Alès. Selon le compte-rendu qu’elles en dressèrent, il leur dit : « Refuser de concélébrer avec le pape serait un acte soupçonnable de schisme [sic]. Nous refusons par ailleurs toute concélébration avec les évêques et avec les abbés. C'est le cardinal Ratzinger qui a donné ce moyen d'avoir une audience (refusée sinon) : assister à la messe du pape, audience ensuite… La messe de Paul VI n'est pas une devenue bonne, elle reste à réformer, mais elle appartient à l'Eglise (prescription de plus de 25 ans), au patrimoine (bon ou mauvais) de l'Eglise ».
De ce compte-rendu, il ressort que Dom Gérard a été l’objet d’une sorte de double chantage de la part du cardinal Ratzinger : pas d’audience s’il refuse de concélébrer la messe de Paul VI ; pas de possibilité de refuser à moins de paraître rebelle voire schismatique. Si ce n’est pas du chantage, c’est en tout cas un étrange stratagème pour obtenir une audience.
Plus inquiétant, ce curieux raisonnement : la messe moderne n’est pas bonne et reste à réformer – c’est donc qu’elle est mauvaise – mais l’Abbé du Barroux la concélèbre parce qu’elle appartient à l’Eglise, moyennant la prescription de « 25 ans » (?). Faut-il comprendre qu’il n’est plus possible de refuser de la dire à partir du premier dimanche de l’Avent 1994, soit 25 ans après son entrée en vigueur, le temps d’une génération ? Etrange argument, lorsque l’on sait que le pape saint Pie V rejeta les rites ne pouvant justifier d’une ancienneté de plus de deux siècles. Et dire que, un an plus tôt, Dom Gérard citait avec habileté dans sa lettre aux Amis du monastère n°70 – celle annonçant la fameuse pétition – les propos de Jean Guitton à propos de la nouvelle messe : « L’intention de Paul VI au sujet de la liturgie, c’est de [la] réformer de manière à ce qu’elle coïncide avec la liturgie protestante (…) au-delà du concile de Trente (…) en donnant une moins grande place à tout ce qu’il y a (…) de consécration substantielle, transsubstantielle, et qui est la foi catholique ». C’était rejoindre l’analyse des cardinaux Ottaviani et Bacci constatant comment la nouvelle messe s’éloignait « de façon impressionnante, dans l’ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la Sainte Messe, telle qu’elle a été formulée à la XXIIe session du concile de Trente ».
Enfin, plus gênant peut-être, le fait que Dom Gérard explique refuser la concélébration avec les évêques et les abbés, mais pas avec le pape. Or un mois avant son déplacement à Rome, le 26 mars 1995, il avait déjà concélébré dans le nouveau rite au cours de la messe de consécration de l’église du monastère de Rosans, au diocèse de Gap. La messe avait été présidée par Mgr Lagrange, évêque du lieu, et les Abbés de Fontgombault, Randol, Triors et du Barroux l’avaient concélébrée. Il faut supposer que Dom Gérard avait oublié ce premier épisode lors de sa conférence aux sœurs bénédictines… La mémoire joue parfois de ces tours.
De ces événements peu glorieux pour qui se souvient de l’ardeur et du zèle déployés par Dom Gérard pour défendre la liturgie traditionnelle et dénoncer le nouveau rite , il ne fut guère question à l’époque. Yves Chiron relève qu’il se garda bien d’en faire mention dans le compte-rendu de l’audience avec le Pape qu’il publia peu après. Il préféra insister sur « la profonde gratitude » que nous devons avoir d’être « attachés à des rites vénérables », faits de « richesse doctrinale » et de « raisons spirituelles » : « notre liturgie [est] une haute école de contemplation et de vie théologale ». En effet. Quant au résultat de sa démarche à Rome, il en résultait un encouragement à s’adresser aux évêques, avec ténacité et persévérance.
La nouvelle messe orthodoxe
Il fallut attendre trois ans pour que Dom Gérard mentionne publiquement la concélébration de la nouvelle messe avec Jean-Paul II. Ce fut au cours du pèlerinage d’action de grâces pour les dix ans du motu proprio Ecclesia Dei. Le 24 octobre 1998, dans une conférence qu’il donna devant le cardinal Ratzinger, il expliqua avoir voulu « montrer par là que nous tous qui militons pour le maintien de l’ancien missel, nous croyons à la validité et à l’orthodoxie du nouveau rite ». A ce compte-là, qu’est-ce qui l’empêchait de le célébrer ? La préférence pour la liturgie traditionnelle ne tenait plus qu’à un fil, celui d’une sensibilité particulière qui ne risquait plus de faire de l’ombre au nouveau rite naguère « naturaliste et moderniste ». L’heure de la capitulation avait-elle sonné ?
A l’abbé Denis Coiffet, supérieur du district de France de la Fraternité Saint-Pierre, qui lui reprochait d’avoir parlé de « l’orthodoxie » du nouveau rite, il répondit par une distinction passablement oiseuse et historiquement fausse, en expliquant qu’il avait parlé d’orthodoxie à propos « évidemment de l’édition typique de l’Ordo Missæ tel qu’il est sorti de l’imprimerie vaticane en 1969, et non de l’aboutissement, lamentable en bien des cas, du processus évolutif auquel il a pu donner naissance ». C’était ignorer le Bref examen critique, paru bien avant la mise en œuvre de la nouvelle messe. Dom Gérard avait déjà utilisé cette argutie en expliquant que, finalement, la messe réformée de Paul VI était orthodoxe et légitime au commencement, à l’état initial, mais que c’était dans son processus évolutif qu'il avait versé dans des abus qu'il fallait combattre. Développé en 1985, l’argument avait été jugé très osé et dangereux par l'abbé Franz Schmidberger, alors Supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X. Mais ici Dom Gérard ajoutait : « Si l’on taxait d’hétérodoxie l’Ordo Missæ en sa teneur initiale, on mettrait en cause le magistère ordinaire universel, et l’on rejoindrait les positions de la Fraternité Saint-Pie X, proche en cela du sédévacantisme » (sic).
Une telle surenchère dans la diabolisation de ses anciens compagnons d’armes cachait-elle quelque chose ? En fait, Dom Gérard avait signé, dix jours plus tôt, un protocole d’accord dans l’espoir de nouer des contacts et d’avoir plus d’influence.
Ultime gage
Une ancienne demande de Dom Gérard pour son monastère, outre sa reconnaissance et sa réintégration dans l’ordre bénédictin, était d’être affilié à la Conférence monastique de France. Cela devait faciliter le travail de normalisation entamé en 1988. Dans ce but, un protocole d’accord avait été signé le 14 octobre 1998, à Paris. En voici les extraits publiés par le biographe de Dom Gérard : « L’abbé et la communauté du Barroux n’ont jamais mis en doute la validité de la messe célébrée selon le rite de Paul VI, et par ailleurs, suite à une étude approfondie du concile Vatican II (notamment sur la liberté religieuse), ils adhèrent désormais unanimement à sa doctrine ». En conséquence, « le Père Abbé accepte : 1) de concélébrer ou d’envoyer son représentant concélébrer avec l’évêque diocésain à la messe chrismale, partout où son monastère est ou sera implanté ; 2) que les moines prêtres de son monastère puissent, s’ils le désirent, concélébrer à la messe conventuelle dans les communautés où ils seront en visite ». Quant aux prêtres en visite à l’abbaye du Barroux, ils pourront, s’ils le souhaitent, célébrer ou concélébrer la messe selon le rite de Paul VI.
Ces engagements étaient la condition sine qua non de l’affiliation du Barroux à la Conférence monastique, qui admit alors par un vote unanime l’abbaye Sainte-Madeleine comme nouveau membre, le 15 décembre 1998. A Jean Madiran, Dom Gérard expliqua que la concélébration était « la preuve en acte que nous ne sommes pas des “lefebvristes infiltrés” » (sic). Dix ans avaient suffi. Longtemps, Dom Gérard avait refusé de concélébrer la nouvelle messe ou s’était esquivé, notamment à l’abbaye de Fleury le 21 mars 1991 ou lors du neuvième centenaire de la fondation de l’abbaye de Fontgombault, le 10 juin 1991. Mais après la « dégringolade » du 27 avril 1995, l’heure de la capitulation avait sonné. Pour obtenir un avantage, il fallait aller de concession doctrinale en concession liturgique, à Rome comme à Paris. Il suffisait d’agiter l’épouvantail du prétendu schisme d’Ecône pour se soumettre sans gloire, en donnant des gages.
Cette politique n’alla pas sans causer des remous au sein du monastère comme parmi les communautés Ecclesia Dei. Les arguments de Dom Gérard pour se justifier se résumaient à : pas de mauvaise querelle – ce serait nous « dialectiser » (il avait utilisé le même terme sur Radio Courtoisie dix ans plus tôt pour signifier qu’il refusait d’être mis en opposition avec la Fraternité Saint-Pie X) ; d’autre part il fallait savoir poser de temps en temps « un signe ecclésial » sous peine de perdre le « sensus Ecclesiæ », le sens de l’Eglise qu’il avait mieux que quiconque.
Il ajoutait que son but restait de « répandre » le rite traditionnel et non pas tant de le « conserver » : « Les ordinaires des diocèses dans la plupart des cas (…) ne concèdent la messe dite de saint Pie V que si les prêtres acceptent, dans les circonstances voulues, de concélébrer avec leur clergé autour de l’évêque, en signe de communion avec lui ». Il fallait donc en passer par là.
Ayant donc obtenu la reconnaissance de son abbaye par la Conférence monastique de France, Dom Gérard put participer à son Assemblée générale à l’abbaye de la Source, à Paris, le 9 décembre 1999. Il y concélébra à nouveau la nouvelle messe.
Conclusion
Le 28 février 1990, Jean-Paul II avait confié à Dom Gérard et à sa communauté « la grande intention de la réconciliation de tous les fils et filles de l'Eglise dans une même communion ». La concélébration de la nouvelle messe, il y a trente ans, en fut le signe et l’accomplissement.
Triste anniversaire, dont le recul du temps permet d’affirmer qu’il n’aura conduit qu’à diviser les forces vives de la Tradition et à permettre, au compte-gouttes, une « expérience de la tradition » sous surveillance et en trompe-l’œil. Traditionis custodes du pape François a rendu la vue depuis. Le seul dénominateur commun aura été d’obtenir des avantages particuliers et limités sur le dos du bon combat de la foi. Mgr Lefebvre n’en était pas l’unique représentant mais sa personnalité et son œuvre en étaient les principales composantes. Elles restent encore aujourd’hui inévitables, Dieu aidant.
Loin des calculs et des reniements intéressés, des abandons souriants avec des airs de fidélité.
Abbé Christian Thouvenot