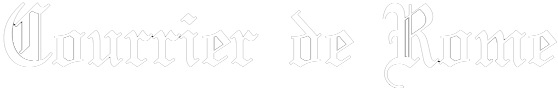Les prêtres de la FSSPX ont-ils la juridiction pour confesser ?
Publié dans le N°684 de la publication papier du Courrier de Rome
Dans sa lettre apostolique Misericordia et veritas du 20 novembre 2016, le pape François accorde à tous les fidèles fréquentant les églises desservies par des prêtres de la Fraternité Saint-Pie X « la faculté de recevoir validement et licitement l’absolution sacramentelle de leurs péchés ». Cette faculté est donnée « jusqu’à ce que soient prises de nouvelles décisions ». Faut-il en conclure que, sans cette faveur papale, ou au terme éventuel de cette faveur papale, les prêtres de la FSSPX ne peuvent pas absoudre validement, par défaut de juridiction ? Que se passera-t-il si le pape actuel meurt et que son successeur met fin à cette faculté ? Et que penser des absolutions données par des prêtres appartenant aux communautés amies de la FSSPX ?
Il est théologiquement certain, en effet, que le ministre du sacrement de pénitence, en plus du pouvoir d’ordre, doit posséder la juridiction. Sans elle, l’absolution est invalide . Habituellement, cette juridiction est donnée aux prêtres par l’évêque diocésain, qui lui-même la reçoit du pape. Mais la FSSPX, en raison de son opposition à la nouvelle messe et aux erreurs de Vatican II, se trouve dans une situation canonique apparemment problématique, si bien que les évêques diocésains accordent rarement la juridiction aux prêtres de cet institut.
Nous nous demandons donc si l’Église supplée la juridiction pour les prêtres attachés à la Tradition. Cette expression « l’Église supplée » signifie que l’Église rend directement valable l’acte qui, par défaut de concession normale de juridiction, eût été nul sans cette suppléance.
L’enjeu est de taille, car si les absolutions sont invalides, alors elles n’effacent pas les péchés.
Notre raisonnement peut être mis en forme sous la forme d’un syllogisme composé d’une majeure, d’une mineure et d’une conclusion.
Majeure : Actuellement nous sommes dans un état de nécessité.
Mineure : Or, en état de nécessité, l’Église supplée la juridiction.
Conclusion : Donc, actuellement, l’Église supplée la juridiction.
1re partie : preuve de la majeure
Nous allons montrer que, en 2025, nous sommes clairement dans un état de nécessité.
Comme l’explique le canoniste Raoul Naz, « on donne le nom de nécessité à l’état créé dans la volonté humaine par l’exercice d’une contrainte, celle-ci résultant de la menace ou de l’application d’un mal, à laquelle on ne peut échapper qu’en produisant un acte déterminé » . Or, aujourd’hui, l’enseignement officiel de l’Église s’éloigne de la vérité tant en dogme qu’en morale. Certaines vérités fondamentales sont occultées alors que des erreurs graves sont publiquement répandues par les plus hautes autorités, par exemple, en matière de morale conjugale. Il en résulte un grave péril pour le salut des fidèles qui reçoivent les sacrements des mains des ministres reconnus officiellement. Ce danger n’est pas isolé. Il concerne le monde entier.
Pendant quelques années, à la suite du concile Vatican II, les absolutions collectives ont rendu rare la confession auriculaire individuelle. Aujourd’hui, dans beaucoup de paroisses, il n’y a plus de pénitent. Là où le sacrement de pénitence est encore en usage, il prend parfois plus la forme d’un dialogue que d’une accusation. En outre, le modernisme a contaminé aussi la théologie morale, si bien que le péril d’être induit en erreur en cette matière n’est pas négligeable.
Le pape François, par le motu proprio Traditionis custodes, limita drastiquement la célébration de la messe dans le rite traditionnel. Par l’exhortation apostolique Amoris lætitia, il permit la communion eucharistique aux divorcés remariés. Par la déclaration Fiducia supplicans, il favorisa la perversité homosexuelle. Par la Déclaration d’Abou Dabi, il encouragea le relativisme religieux. Les plus hautes autorités de l’Eglise ont posé d’innombrables actes scandaleux qui accentuent la crise de la foi et de la morale.
Mais l’état de nécessité existait déjà avant le pape François. Dès la fin du concile Vatican II, les autorités de l’Eglise ont répandu de graves erreurs théologiques, mettant ainsi en danger le salut des âmes.
L’existence de communautés autrefois appelées Ecclesia Dei ne fait pas disparaître l’état de nécessité. Il est vrai qu’il existe, dans ces communautés ou ailleurs, de bons prêtres dont la doctrine est moins contaminée par le modernisme. Cependant, le concile Vatican II reste une source prochaine de corruption tant que les autorités l’acceptent. De plus, ces prêtres conservateurs fidèles à la messe traditionnelle sont souvent tièdes pour attaquer publiquement les erreurs actuelles et armer leurs paroissiens contre les périls. Ils savent très bien que, s’ils enseignent la vérité sans mélange et dénoncent courageusement l’erreur, ils seront chassés de leur diocèse par les autorités ecclésiastiques. Ils sont muselés. Leur liberté de parole est très limitée. D’où un danger pour la foi, à long terme, chez les fidèles qui reçoivent les sacrements chez eux.
2e partie : preuve de la mineure
Nous allons prouver que, en cas de nécessité, l’Eglise supplée la juridiction pour confesser.
1. En cas de nécessité, comment faut-il se comporter, d’après l’esprit de l’Église ?
Le droit d’une société ne peut pas prévoir le cas où la majorité de ses autorités agirait en dehors de sa mission. En effet, ce qui est en dehors des règles ne peut pas être mis en règle. De plus, une telle législation serait ruineuse de l’ordre car tout subordonné serait tenté de voir dans les décisions des supérieurs qui lui déplaisent, une manifestation de trahison. En outre, les cas de défaillance sont innombrables. Il est impossible de fixer des règles pour tous les dysfonctionnements possibles. Par conséquent, on ne trouvera pas dans la loi de l’Église des règles toutes faites pour diriger l’action en période de crise. La synésis ne suffisant pas à résoudre les cas extraordinaires, il faudra faire appel à la vertu de gnomé . Comme l’explique saint Thomas , en effet, une vertu spéciale est nécessaire pour les cas embarrassants et exceptionnels, car ils doivent être jugés en dehors des lois communes.
Nous nous trouvons dans une situation où les lois de l’Église, bonnes en elles-mêmes, nuisent au bien commun hic et nunc. Ce cas n’est pas nouveau mais requiert, outre la vertu de gnomé, celle d’épikie. Saint Thomas, dans la Somme théologique, l’explique : « Les législateurs considèrent ce qui arrive d’ordinaire, et s’en inspirent pour faire une loi dont l’observation, en certains cas extraordinaires, irait contre la justice et le bien public que la loi entend précisément sauvegarder. Par exemple, un homme a confié à quelqu’un une épée. Devenu fou, il la redemande. Ou encore, un traître réclame un dépôt d’argent dont il veut faire usage contre sa patrie. En pareils cas et autres semblables, obéir à la loi, ce serait mal agir ; au contraire, c’est bien agir que de négliger la lettre de la loi pour faire ce qu’exigent la justice et le bien public. Telle est la fonction de la vertu d’épikie » . Ce que résume le Docteur angélique par l’adage : « Nécessité n’a pas de loi » . Par exemple, en temps de persécution, un prêtre déporté pourrait dire la messe sans pierre d’autel, ni corporal grec ni chasuble. C’est ce qu’explique Pie XII : « Le notaire sait qu’aucun énoncé juridique ne réussit à couvrir parfaitement les données d’un cas déterminé ; que de fois n’est-il donc pas amené à suppléer à leur silence ou à leur ambiguïté ! Parfois même il dépassera franchement la lettre de la loi pour en conserver mieux l’intention. Car les lois elles-mêmes ne sont pas un absolu ; elles cèdent le pas à la conscience droite et bien formée et l’on reconnaît le véritable homme de loi à la compétence qu’il apporte dans l’interprétation des textes en vue du bien supérieur des individus et de la communauté » . Pie XII dit aussi aux juges du Tribunal de la Rote : « Tandis que l’activité juridique unilatérale contient toujours en soi le danger d’un formalisme exagéré et de l’attachement à la lettre, la sollicitude des âmes garantit un contre-poids en maintenant claire dans la conscience la maxime : Leges propter homines, et non homines propter leges » .
Le canoniste Naz écrit dans le même sens : « On peut conclure à la caducité d’une loi dès qu’elle cesse de correspondre aux exigences du bien commun dans une région, en soutenant, par épikie, qu’elle excède le pouvoir du législateur dont l’activité ne doit s’exercer qu’en vue de ce même bien commun » .
Le droit canonique donne des principes pour agir quand on se trouve dans une situation non prévue par le droit. Il s’agit du canon 20 (canon 19 du nouveau Code) : « S’il n’existe aucune prescription ni dans la loi générale ni dans la loi particulière relativement à une espèce déterminée, on doit chercher une règle, à moins qu’il ne s’agisse d’infliger une peine, dans les lois portées pour des espèces semblables, dans les principes généraux du droit observés d’après l’équité canonique , dans le style et la pratique de la Curie romaine, dans l’opinion commune et constante des docteurs ».
Etudions donc les principes généraux du droit et les lois portées pour des espèces semblables.
2. Les principes généraux du Droit de l’Église
Suprema lex salus animarum.
La loi suprême est le salut des âmes. Dans le Code de 1917, ce principe n’est pas écrit en toutes lettres, mais il est sous-jacent à de très nombreuses règles canoniques . Saint Thomas écrit : « La fin du droit canonique tend à la paix de l’Église et au salut des âmes » . Dans le même sens, le pape canoniste Benoît XIV précise : « Les sacrés canons de l’Église ne regardent rien d’autre que l’équité et le salut des âmes » . Tel est le principe directeur de tout le droit canonique.
Dans le Code de 1983, il est mentionné aux canons 747 et 1736. Le tout dernier canon du nouveau Code s’achève ainsi : « sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l’Église la loi suprême ».
Le salut des âmes étant la loi suprême de l’Église, les autres lois ecclésiastiques doivent lui être ordonnées. Si dans un cas particulier une loi nuisait à l’obtention de cette fin, il ne faudrait pas suivre cette loi particulière. En appliquant ce principe à notre sujet, nous voyons que la loi qui restreint la juridiction a pour but, ordinairement, le bien des âmes. Si dans un cas particulier cette loi nuisait au salut des âmes, il ne faudrait pas la suivre.
Sacramenta propter homines bene dispositos.
Les sacrements sont pour les hommes bien disposés. Ce principe découle directement du précédent. En effet, le salut des âmes s’obtient principalement par les sacrements. Par conséquent, si le fidèle est bien disposé, rien ne doit s’opposer à ce qu’il puisse recevoir les sacrements. De plus, le bien commun requiert que les fidèles puissent les recevoir aisément. Donc si, dans une situation particulière, une loi ecclésiastique empêche que les fidèles bien disposés reçoivent les sacrements, cette loi perd sa force de loi devant une loi supérieure. C’est ce principe qui est à l’origine, par exemple, de la recommandation faite au canon 878 (CIC 1983 can. 974) : « L’ordinaire du lieu, et même le supérieur compétent, ne révoqueront pas la concession de la faculté d’entendre habituellement les confessions, sinon pour une cause grave ».
C’est aussi en vertu de ce principe que le nouveau Code a voulu élargir la faculté de confesser. Avant 1983, un prêtre ne pouvait confesser validement que dans son diocèse. Dorénavant, il confesse validement partout, pourvu qu’il ait la faculté de confesser (CIC 1983 can. 967).
Les fidèles ont droit aux moyens de salut.
Ce principe, conséquence des deux précédents, est exprimé au canon 682 (CIC 1983 can. 213) : « Les laïques ont le droit (jus habent) de recevoir du clergé, conformément aux règles de la discipline ecclésiastique, les biens spirituels et spécialement les secours nécessaires au salut ».
Propter necessitatem, illicitum efficitur licitum.
La nécessité rend licite ce qui est illicite. Cette règle du droit se trouve dans les Décrétales de Grégoire IX. Elle rejoint l’axiome « Nécessité n’a pas de loi ». Son usage requiert la vertu de prudence. Cette règle ne concerne que le droit positif. Le droit naturel, en effet, n’admet pas d’exception. Or, la loi qui limite la juridiction pour confesser relève du droit positif ecclésiastique et non du droit naturel. La règle mentionnée s’applique donc.
3. Les lois portées dans des cas similaires
C’est ce qu’on appelle l’analogie du droit. Elle consiste à appliquer les dispositions concernant une matière déterminée à d’autres matières que le législateur n’avait pas prévues. Nous allons voir que le Droit canon donne très facilement à tous les prêtres la juridiction, de façon ordinaire, déléguée ou supplétoire ; que l’Église veut que ses fidèles puissent facilement recevoir les sacrements ; que l’Église supplée en de nombreux cas une juridiction manquante afin d’assurer la validité des sacrements, pour le bien des âmes.
- Les actes commis par inadvertance après la cessation de la juridiction
L’Église prévoit dans ce cas la suppléance de la juridiction, au canon 207§2 (CIC 1983 can 142) : « En cas de juridiction donnée pour le for interne, si un acte a été accompli par inadvertance après que le temps de la juridiction est écoulé, ou que le nombre des cas permis est épuisé, cet acte est valide ».
- Les actes de ministres excommuniés
De tels ministres ont l’interdiction d’administrer les sacrements. Cependant, pour le bien des âmes, l’Église suspend cette interdiction, non seulement en cas de nécessité grave, mais aussi, à certaines conditions, pour toute juste cause : « Si une censure défend de célébrer les sacrements ou les sacramentaux, ou de poser des actes de gouvernement, cette défense est suspendue chaque fois que cela est nécessaire pour secourir les fidèles en danger de mort ; si la censure latae sententiae n’a pas été déclarée, la défense en outre est suspendue toutes les fois qu’un fidèle réclame un sacrement ou un sacramental ou un acte de gouvernement : ce qu’il est permis de demander pour toute juste cause ». (CIC 1983 can. 1335 ; CIC 1917 can. 2261).
- Le péril de mort
Dans ce cas, l’Église donne la juridiction par suppléance à tout prêtre, même hérétique, schismatique, apostat ou réduit à l’état laïc : « En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d’entendre les confessions, absout validement et licitement de toute censure et de tout péché tout pénitent, même en présence d’un prêtre approuvé » (CIC 1983 can. 976 ; CIC 1917 can. 882).
- Le doute positif et probable
Il s’agit du cas où le prêtre n’a pas la certitude de posséder la juridiction. Certaines raisons sérieuses lui font dire qu’il l’a. Mais les arguments en sens contraire sont solides. Ce doute peut porter sur le droit (quel est exactement le sens de la loi ?) ou sur le fait (ex : Je ne sais pas si mon supérieur m’a donné la juridiction). Dans cette situation, l’Église supplée la juridiction (CIC 1917 can. 209 ; CIC 1983 can. 144) : « En cas d’erreur commune ou de doute positif et probable, sur un point de droit ou de fait, l’Église supplée la juridiction pour le for tant externe qu’interne ». Il y a suppléance de juridiction même si le prêtre, de bonne foi, se persuade faussement d’une probabilité, qui en réalité n’a pas de fondement . Une raison seulement légère est requise pour l’usage licite de cette suppléance, d’après l’opinion commune des canonistes . Par exemple, un fidèle demande à se confesser, mais le prêtre n’est pas sûr d’avoir la juridiction. Le prêtre confesse alors validement et licitement.
- L’erreur commune
Il s’agit du cas où les fidèles pensent à tort que le prêtre possède la juridiction. Si cette erreur se fonde sur un fait apte par sa nature à provoquer l’erreur dans une bonne partie de la communauté, même si de fait peu de gens sont trompés , alors l’Église supplée la juridiction. Par exemple, la veille d’une grande fête, un prêtre est présent dans l’église. Il n’a pas juridiction mais les fidèles pensent qu’il l’a, parce qu’habituellement le curé invite un confesseur extraordinaire les veilles de grandes fêtes. Si ce prêtre confesse, ses absolutions seront valides. Le prêtre conscient de son défaut de juridiction peut-il se prévaloir de l’erreur commune pour confesser ? Le fidèle, au courant de l’erreur commune, peut-il recourir à la juridiction du prêtre, qui ne la possède que par suppléance de l’Église ? Le Tribunal de la Rote romaine répond affirmativement à ces deux questions, pourvu qu’il existe une “cause juste”. La difficulté pour les fidèles à trouver un autre confesseur avant la fête du lendemain est une cause juste . En cas de grave nécessité, le prêtre pourrait même licitement provoquer l’erreur commune, par exemple en s’asseyant au confessionnal . Naz dit même que, si le bien des âmes le demande, un prêtre dépourvu de juridiction pourrait être tenu de se mettre à la disposition des fidèles, en profitant de sa juridiction due à la suppléance de l’Église .
4. Une objection
Quelqu’un pourrait objecter : à vous entendre, l’Église ne devrait jamais restreindre la juridiction pour confesser. Pourtant, l’Église a toujours veillé à ne donner la juridiction qu’à des ministres aptes et dignes, sauf en cas de péril de mort. Donner le pouvoir de confesser à n’importe quel prêtre peut causer du dommage aux âmes. De ce fait, des ministres inaptes ont parfois l’obligation de refuser les sacrements pour ne pas les entacher de nullité ou d’illicéité. Par exemple, en 1997, la commission d’interprétation du Code a rappelé l’interdiction aux fidèles, sauf péril de mort, de se confesser à un prêtre ayant attenté mariage. Ce clerc est en effet « dans une situation d’absence objective d’idonéité pour remplir le ministère pastoral » .
Nous répondons à l’objection : en effet, en dehors du cas de péril de mort, l’Église refuse de donner la juridiction à un clerc ne possédant pas les qualités nécessaires pour remplir le ministère pastoral. Cependant, les prêtres de la FSSPX appartiennent à un institut dont les statuts ont été approuvés et loués par l’Église. La personnalité morale canonique de la FSSPX est difficilement contestable puisqu’elle est reconnue comme société de vie apostolique par les autorités romaines. En effet, les concessions en matière du sacrement de pénitence ou du sacrement du mariage ont été confiées à la FSSPX, prise en la personne de tous ses supérieurs, et non point individuellement, à chaque prêtre qui aurait été destinataire de cette concession . Enfin, le sérieux de la formation de ses prêtres et de la discipline interne de leur société permet de conclure que, s’ils en ont reçu l’autorisation de leurs supérieurs, ils sont aptes à confesser. Sans la crise de l’Église et le modernisme, ils auraient tous les pouvoirs nécessaires.
5. Annexe : argument ad hominem
Les canonistes modernes qui ont réformé le Code en 1983 ont voulu y introduire l’œcuménisme de Vatican II, si contraire à toute la Tradition de l’Église. Le nouveau canon 844 §2 dit en effet : « Chaque fois que la nécessité l’exige ou qu’une vraie utilité spirituelle s’en fait sentir, et à condition d’éviter tout danger d’erreur ou d’indifférentisme, il est permis aux fidèles qui se trouvent dans l’impossibilité physique ou morale d’avoir recours à un ministre catholique de recevoir les sacrements de pénitence, d’Eucharistie et d’onction des malades de ministres non catholiques, dans l’Église desquels ces sacrements sont valides » .
Comment dès lors prétendre que des fidèles catholiques pourraient légitimement aller se confesser auprès de prêtres acatholiques (par exemple orthodoxes), mais non auprès des prêtres de la FSSPX ?
Conclusion
Ces cas prévus par le droit de l’Église permettent de conclure avec la certitude suffisante que l’Église, lorsque le salut des âmes le demande, supplée la juridiction pour les prêtres qui en seraient dépourvus. C’est donc la nécessité des fidèles qui fonde la juridiction de suppléance. Cette juridiction est davantage de type personnel que territorial. Elle n’est pas habituelle mais s’exerce “per modum actus”, ce qui signifie que le prêtre ne la possède pas en permanence, mais seulement lorsqu’un fidèle veut se confesser.
Mgr Lefebvre écrivait aux membres de l’institut qu’il a fondé : « Tandis que le pouvoir d’ordre est inamissible, le pouvoir de juridiction est conféré par la mission canonique. N’ayant pas de mission canonique nous n’avons pas de juridiction par le fait d’une mission, mais l’Église, par le droit, nous accorde la juridiction, eu égard au devoir qu’ont les fidèles de se sanctifier par la grâce des sacrements, qu’ils recevraient difficilement ou douteusement s’ils ne la recevaient pas de nous. Nous recevons donc juridiction au cas par cas pour venir au secours d’âmes en détresse. (…) Pour la pénitence, c’est le pénitent, se trouvant dans de réelles difficultés pour recevoir la grâce de ce sacrement, qui provoque l’obligation pour le prêtre dénué de juridiction d’entendre la confession. Celui-ci reçoit par le fait même la juridiction par le droit qui prévoit ces circonstances » .
Ces lignes s’harmonisent parfaitement avec ce qu’écrit saint Thomas d’Aquin : « Tout prêtre, pour ce qui est du pouvoir des clés, a puissance sur tous les fidèles et quant à tous les péchés sans distinction. S’il ne peut pas absoudre tous les péchés, c’est parce que, de par une loi de l’Église, il n’a qu’une juridiction limitée ou n’en a pas du tout. Mais comme “la nécessité n’a pas de loi”, si le cas de nécessité se présente, la loi de l’Église n’empêche pas que le prêtre absolve même sacramentellement, dès lors qu’il a la puissance des clés, et cette absolution du prêtre étranger vaut autant que celle du propre prêtre. Et non seulement tout prêtre peut alors absoudre du péché, mais il peut absoudre aussi de l’excommunication, quel que soit celui qui l’a portée, car cette absolution relève aussi de la juridiction dont la limite vient d’une loi ecclésiastique » .
Si un objectant admet que notre argumentation est sérieuse, mais qu’un doute subsiste, alors nous répondons qu’en cas de doute positif et probable, l’Église supplée la juridiction. La validité des absolutions données par les prêtres fidèles à la Tradition est donc certaine, même sans la faveur accordée par le pape François en 2016.
Abbé Bernard de Lacoste