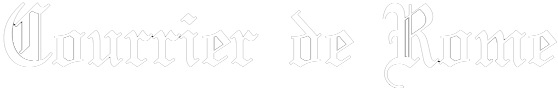LES SACRES (SUITE … ET FIN ?)
Publié dans le N°684 de la publication papier du Courrier de Rome
1. On ne peut pas quitter sa génération, pas plus que, selon le mot de Nietzsche, on ne peut sauter hors de son ombre. Or, la génération de ce siècle écoulé, depuis le dernier Concile œcuménique, est celle d’une grande confusion intellectuelle. Comme les Hébreux idolâtrant le veau d’or, elle s’est prosternée devant les sophismes d’un véritable « terrorisme intellectuel », pour reprendre l’expression de Jean Sévillia . Ce terrorisme « refusant tout débat de fond sur les questions politiques et sociales qui engagent l’avenir, vise à ôter toute légitimité à son contradicteur, en l’assimilant par amalgame aux personnages, aux faits, et aux théories du passé ou du présent qui symbolisent le mal absolu selon les critères alors dominants dans le milieu culturel et médiatique » .
2. Ce terrorisme a sévi, dès les premières origines de celle-ci, à l’encontre de l’œuvre fondée par Mgr Lefebvre. Depuis « Le Séminaire sauvage » et « L’évêque suspens », dans les années soixante-dix, jusqu’aux « catholiques intégristes » et aux « fondamentalistes lefebvristes » des années deux-mille, en passant par le « Schisme d’Ecône » et « la Tradition excommuniée » dans les années de l’après 1988, la Fraternité Saint Pie X n’a cessé d’essuyer les assauts d’un appareil médiatique visiblement acharné à occulter, aux yeux du grand public, toute explication d’ordre proprement théologique.
Une argumentation qui se voudrait théologique.
3. On aurait tort, pourtant, de croire que cet ostracisme superficiel représente la seule réaction opposée à la Fraternité Saint Pie X. Pour prendre une dimension aussi prévalente, ce terrorisme médiatique ne représente pas la seule offensive qui entend se confronter - pour leur dénier toute expression crédible - aux forces vives de la Tradition. Au-delà des amalgames simplistes et des slogans caricaturaux, les objections d’ordre proprement doctrinal et théologique n’ont pas manqué de se faire entendre, elles aussi, dès le début. Elles sont d’abord venues de Rome, dans des textes officiels et, à partir de 1988, elles sont aussi venues de la mouvance Ecclesia Dei. L’une des dernières en date a fait la matière d’un dossier spécial de 22 pages, paru dans le numéro de ce mois de mars de la revue La Nef , sous le titre « La Fraternité Saint Pie X : quelle place dans l’Eglise ? ». Elle vient d’être suivie, sur le site de la même revue, d’un long article intitulé « La FSSPX est-elle en situation objective de schisme ? ». La conclusion en est que « la situation canonique de la FSSPX est objectivement schismatique ».
4. Ces attaques renouvelées se donnent le prétexte d’une supposée future consécration épiscopale au sein de la Fraternité Saint Pie X . Mais elles ne représentent rien de vraiment nouveau, et elles sont seulement répétées, car elles ne font que reprendre la teneur substantielle d’une argumentation déjà développée dans l’étude initiale, publiée au lendemain des sacres du 30 juin 1988, par les fondateurs de la Fraternité Saint Pierre. Intitulé Du sacre épiscopal contre la volonté du Pape, avec application aux sacres conférés le 30 juin par Mgr Lefebvre, cet opuscule d’environ 80 pages a pour sous-titre : « Essai théologique collectif de membres de la Fraternité St. Pierre, sous la direction de M. l’abbé Josef Bisig ». Une deuxième édition partiellement augmentée et corrigée [sans date] est d’ailleurs disponible depuis deux ans sur le site de la Fraternité Saint Vincent Ferrier . La conclusion de cette étude, qui voudrait établir l’illégitimité des sacres de 1988, repose sur un seul argument décisif : l’état de nécessité ne saurait en tout état de cause justifier une consécration épiscopale contraire à la volonté explicite du Pape, puisque celle-ci est contraire au droit divin. A cet argument fondamental, les responsables de la mouvance Ecclesia Dei voudraient en ajouter aujourd’hui un deuxième, et celui-ci consiste à dire que, depuis le Motu proprio Ecclesia Dei afflicta, la crise de l’Eglise ne va pas jusqu’à justifier un état de nécessité, puisque Rome entend donner satisfaction aux revendications des catholiques attachés à la Tradition, argument fragile et aléatoire, puisqu’il dépend de la manière dont Rome applique ce Motu proprio, le Pape François n’étant pas animé de la même bienveillance que ses deux prédécesseurs immédiats. Ajoutons que La Nef, quant à elle, semble bien, sous la plume de Monsieur Geffroy, minimiser la crise de l’Eglise, au point de ne plus voir dans la réforme liturgique de Paul VI un aspect problématique. Sans compter l’article du Père Basile qui entend disculper les textes de Vatican II de toute nouveauté en rupture vis-à-vis du Magistère antérieur. Il pourrait y avoir ici la matière d’un troisième argument, lequel, s’il en était, consisterait seulement à nier la réalité d’une crise de l’Eglise.
La crise de l’Eglise.
5. L’argumentation de départ, développée en 1988 par l’abbé Bisig et par le Père de Blignières, ne nie pas la réalité d’une crise dans l’Eglise, au moins pour ce qui concerne la célébration du culte liturgique. Revenant sur l’initiative qui aboutit, au cours de l’été 1988, à la fondation de la Fraternité Saint Pierre , le Père de Blignières manifeste qu’il admet lui-même cette réalité :
« La crise elle-même se manifeste de façon aiguë après le concile Vatican II, notamment dans le domaine de la doctrine de la foi, de la catéchèse et de la liturgie. L’existence de cette crise est un fait bien documenté, qui n’est aujourd’hui plus guère remis en question, à la différence du déni qui a marqué les années 60 et 70 » .
6. Le Père ajoutait même ces réflexions, de concert avec l’abbé Josef Bisig, dans une réponse donnée à l’un de nos articles :
« Nous sommes conscients de la situation dramatique de crise dans l’Église. Nous constatons que bien des pasteurs ne font pas leur devoir, quand ils ne donnent pas l’exemple de scandales dans la foi et les mœurs. Nous voyons que certains actes et certaines omissions de la hiérarchie favorisent l’hérésie et la destruction des structures » .
7. Et l’institution des toute premières communautés de ce qui allait devenir la mouvance Ecclesia Dei s’explique, dans l’intention de leurs fondateurs, dont le Père de Blignières, par la volonté de résister à la « genèse révolutionnaire » et aux « déficiences liturgiques » de la nouvelle messe de Paul VI :
« Contrairement à des imputations récurrentes, cet attachement à la messe traditionnelle ne se réclamait pas (ne se réclame toujours pas) du bénéfice du pluralisme. Il ne relève pas seulement d’une sensibilité esthétique. Il s’appuie sur un jugement théologique et pastoral, certain à nos yeux. Ce jugement est fondé sur la genèse révolutionnaire, sur les déficiences liturgiques du Nouvel Ordo Missæ et sur ses fruits » .
L’impossible consécration épiscopale.
8. Peut-on en conclure que ces fondateurs de la mouvance Ecclesia Dei admettaient l’existence d’un état de nécessité dans l’Eglise ? Ils l’ont admis et reconnu jusqu’à l’été 1988, puisque, avant cette date, ils passèrent outre les limitations et les interdits de la loi ecclésiastiques afin de pouvoir célébrer la messe selon le Missel de saint Pie V et recevoir l’ordination sacerdotale selon le même rite traditionnel. En effet, Josef Bisig fut ordonné prêtre par Mgr Lefebvre le 29 juin 1977 et Louis-Marie de Blignières le fut deux mois plus tard, le 25 août 1977, par le même évêque, alors que celui-ci était déjà suspens, depuis les ordinations du 29 juin 1976. Cependant, à leurs yeux, cet état de nécessité ne pouvait aller jusqu’à justifier un consécration épiscopale accomplie contre la volonté de Rome et c’est pourquoi ces fondateurs n’ont vu d’autre solution que de se désolidariser du choix fait par Mgr Lefebvre. Car, selon eux, à la différence des ordinations sacerdotales, dont l’accomplissement contraire à la volonté du Pape va à l’encontre du droit ecclésiastique et devient légitime en cas de nécessité, les consécrations épiscopales, si elles sont accomplies pareillement à l’encontre de la volonté du Pape, contredisent le droit proprement divin et ne sauraient être légitimées par un quelconque état de nécessité. Le Père de Blignières s’en explique fort bien :
« Ce qui a guidé les traditionalistes qui ont refusé les sacres sans mandat, ce n’est pas une question de tactique. Si des prêtres ont fait le sacrifice de quitter (sans aucune garantie d’avenir) la FSSPX, ce n’est pas non plus en vertu d’une conception erronée de l’obéissance, ou dans la perspective des avantages pratiques d’une reconnaissance canonique (qui n’était nullement acquise). Ce qui était et qui est en cause, c’est un jugement de fond sur la communion hiérarchique comme élément essentiel de la foi et de la structure de l’Église catholique. Ce jugement est le suivant : un sacre contre la volonté du Pape est un acte intrinsèquement mauvais parce qu’il porte atteinte à un élément de la foi catholique. La nature même de l’épiscopat catholique comporte l’apostolicité, non pas seulement matérielle (apostolicité qui découle d’un sacre valide même chez les dissidents), mais formelle. Pour être un successeur des apôtres, l’évêque doit être légitimement sacré, au sein de la communion hiérarchique entre tous les évêques catholiques. Et le garant de cette communion, c’est l’évêque de Rome, le successeur de Pierre. De telle sorte que la consécration épiscopale reçue sans l’institution pontificale constitue " un très grave attentat à l’unité même de l’Église " »
Le Motu proprio de Jean-Paul II et la fin supposée de l’état de nécessité
9. Au lendemain des sacres de 1988, avec le Motu proprio Ecclesia Dei afflicta, l’état de nécessité cessa d’exister à leurs yeux, du fait même que le Pape Jean-Paul II manifestait la volonté de « faciliter la pleine communion ecclésiale des prêtres, des séminaristes, des communautés religieuses ou des religieux individuels ayant eu jusqu'à présent des liens avec la Fraternité fondée par Mgr Lefebvre et qui désirent rester unis au successeur de Pierre dans l'Eglise catholique en conservant leurs traditions spirituelles et liturgiques, à la lumière du protocole signé le 5 mai par le cardinal Ratzinger et Mgr Lefebvre » (§ 6, a), « cela par une application large et généreuse des directives données en leur temps par le Siège apostolique pour l'usage du missel romain selon l'édition typique de 1962 » (§ 6, c qui donne référence à la Lettre Quatuor abhinc annos de 1984). Ainsi, pensaient-ils, Rome semblait donner à la crise de l’Eglise la vraie solution, en même temps qu’elle condamnait comme telle la fausse solution de Mgr Lefebvre.
10. Mais l’état de nécessité ne cessait pas pour autant. Car la nécessité dont il est ici question est celle qui rend licite en certaines circonstances ce qui ne le serait pas autrement en raison de la loi humaine, civile ou ecclésiastique . Or, l’état de la crise de l’Eglise, depuis le Motu proprio Ecclesia Dei afflicta, rend toujours licite l’attitude suivie jusqu’ici par la Fraternité Saint Pie X. En effet, les mesures prises par Jean-Paul II, apparemment en faveur des catholiques soucieux de garder la Tradition, ne suffisent pas à neutraliser la crise et maintiennent en réalité dans leur principe les causes profondes de la diminution et de la perte de la foi, diminution et perte généralisées tant au niveau de l’expression liturgique que doctrinale. Car il s’agit bien ici de « faciliter la pleine communion ecclésiale » et celle-ci doit se faire dans l’adhésion aux enseignements du concile Vatican II et dans la reconnaissance de la légitimité de la réforme liturgique de Paul VI – dont l’exigence est maintenue envers et contre toutes les « traditions spirituelles et liturgiques » des catholiques de la mouvance Ecclesia Dei.
11. De fait, les fondateurs de ladite mouvance, quand ils ne l’affirment pas clairement, se comportent comme si la résistance aux réformes du concile Vatican II, là où celles-ci scandalisent les fidèles dans leur foi et leurs mœurs ou favorisent l’hérésie et la destruction des structures ecclésiales, doit se faire dans le respect de la loi ecclésiastique, et n’est pas licite si elle se met en opposition avec les décisions de la hiérarchie. Il n’est donc plus question pour eux, depuis 1988, non seulement de procéder à des consécrations épiscopales, mais même aussi de procéder à des ordinations sacerdotales ou tout simplement de célébrer la messe selon le Missel de saint Pie V, dès lors que tout cela est accompli contre la volonté de Rome. La résistance, s’il en est une, doit à leurs yeux se faire désormais dans la légalité et dans l’obéissance à une Rome désormais revenue à de meilleurs sentiments vis-à-vis de la Tradition.
Une méprise fatale.
12. L’on devait cependant douter de ces sentiments, puisque la légalité n’était accordée par Rome qu’à la condition de reconnaître le bien-fondé des réformes dont découlent nécessairement le scandale, l’hérésie et la destruction des structures ecclésiales, contre lesquels les prêtres qui se désolidarisaient de Mgr Lefebvre étaient censés devoir résister. Car l’application « large et généreuse » des dispositions voulue par Jean-Paul II en faveur de la liturgie traditionnelle a pour but de « faciliter la pleine communion ecclésiale », qui repose tout entière sur le triple lien de l’unité d’un nouveau culte rénové dans un sens protestant, d’une nouvelle doctrine sociale libérale et indifférentiste, et d’un nouveau gouvernement collégialiste et synodal. Accepter ces dispositions de Rome dans le but mortifère voulu par la même Rome suppose, sous peine de contradiction, et quoi qu’il en soit dans l’intention d’un abbé Bisig ou d’un Père de Blignières, que la gravité du scandale, de l’hérésie et de la destruction des structures ecclésiales n’est pas telle qu’elle autorise à passer outre la loi ecclésiastique : le non-respect de cette loi, dont la mise en pratique donne libre cours à la tyrannie mortelle de cette nouvelle communion ecclésiale, est logiquement supposé toujours pire que cette tyrannie même, à laquelle l’on se propose de résister, au prix d’une inconséquence suicidaire. La résistance en devient très relative, tout comme les maux auxquels elle est censée résister, au risque même de perdre une grande part de son efficacité, et de se réduire à la revendication d’une tolérance pour la vérité et le bien, aux côtés de l’erreur et du mal. Telle fut la logique du Motu proprio Summorum pontificum de Benoît XVI, qui inspire encore le Motu proprio Traditionis custodes de François. Telle est la logique foncière du libéralisme, qui est de tous les temps et qui prend aujourd’hui, dans la mouvance Ecclesia Dei, le visage trompeur d’une supposée légalité, en réalité légaliste, c’est-à-dire préjudiciable au véritable bien commun de l’Eglise.
13. Tel est d’ailleurs le constat - des plus lucides – donné par l’article du numéro de mars 2025 de La Nef, intitulé « Traditionis custodes justifie-t-il a posteriori les sacres de 1988 ? » et signé par Pierre Louis (p. 28-29) : « Nulle part, les papes Jean-Paul II et Benoît XVI n’ont jamais reconnu ni authentifié un " charisme d’exclusivité " rituelle, c’est-à-dire d’exclusion de la forme rituelle communément en vigueur dans l’Église latine. Jean-Paul II, dans le Motu proprio Ecclesia Dei, appelait à une prise de " conscience nouvelle non seulement de la légitimité mais aussi de la richesse que représente pour l’Église la diversité des charismes et des traditions de spiritualité et d’apostolat ", cette diversité constituant " la beauté de l’unité dans la variété ", à la manière d’une " symphonie que, sous l’action de l’Esprit Saint, l’Église terrestre fait monter vers le ciel ". On se situe bien là dans l’axe d’une pluralité et non d’un repliement unilatéral sur une forme liturgique donnée. Benoît XVI, dans sa Lettre accompagnant le Motu proprio Summorum Pontificum, écrivait de même : " Évidemment, pour vivre la pleine communion, les prêtres des communautés qui adhèrent à l’usage ancien ne peuvent pas non plus, par principe, exclure la célébration selon les nouveaux livres. L’exclusion totale du nouveau rite ne serait pas cohérente avec la reconnaissance de sa valeur et de sa sainteté ". Il est donc clair que le Siège apostolique ne s’est jamais engagé à l’égard des traditionalistes à ce que ces derniers puissent revendiquer, au nom de l’Église, le refus du missel rénové ou à ce qu’ils puissent en interdire l’usage dans leurs rangs ». Le Siège apostolique s’est engagé à faciliter la nouvelle communion ecclésiale de Vatican II aux catholiques jusqu’ici demeurés fidèles à l’Eglise de toujours. Ni plus ni moins.
14. Et de fait, la stratégie romaine a fini par atteindre son but : les principaux représentants de la mouvance Ecclesia Dei, le Père de Blignières, l’abbé Lucien, le Père Basile du Barroux, en sont venus à défendre l’impossible continuité des enseignements conciliaires avec la Tradition, spécialement sur la question de la liberté religieuse.
A la racine du problème : la définition de l’épiscopat.
15. L’erreur fondamentale des fondateurs de la mouvance Ecclesia Dei, qui demeure aujourd’hui la même, près de quarante ans après, au point de servir de base à toute l’argumentation opposée à de nouvelles consécrations épiscopales dans la Fraternité, porte sur la nature même de l’épiscopat. Nous en avons traité en détail et renvoyons nos lecteurs ici aux articles déjà parus sur le sujet dans le Courrier de Rome .
16. L’épiscopat est dans l’Eglise une institution divine. Sa nature nous est indiquée par les sources de la Révélation. L’épiscopat correspond en réalité à un double pouvoir, le pouvoir de juridiction et le pouvoir d’ordre. Ce pouvoir, institué par le Christ, est double du point de vue des définitions formelles ; mais il est un d’une unité d’ordre, du point de vue de l’exercice. Les deux pouvoirs sont formellement distincts non seulement en raison de leur objet, mais encore en raison de la manière dont ils sont communiqués. Le pouvoir de juridiction est précisément le pouvoir qui est au fondement de l'autorité dans une société, donc dans l’Eglise, par analogie avec la société civile. C’est le pouvoir royal du Christ. Il est acquis par une investiture. Le pouvoir d’ordre est le pouvoir de réaliser les sacrements, ici les sacrements de l’ordre et de la confirmation. C’est le pouvoir sacerdotal du Christ. Il est acquis par une consécration. Ces deux pouvoirs essentiellement distincts sont unis, dans une unité d’ordre, car chacun dépend de l’autre dans son exercice et c’est pourquoi ils sont le plus souvent sinon ordinairement exercés par un seul et même sujet, même s’ils peuvent se trouver dans des sujets différents . La raison de cette interdépendance au niveau de l’exercice et de la conjonction des pouvoirs dans leur sujet découle donc de ce que, de ces deux pouvoirs, l’exercice de l’un est la fin de l’autre. La juridiction est en vue de l’ordre . De fait, le Christ est à la fois souverain prêtre et souverain roi. Cette nécessité qui relie concrètement dans un même sujet en vue d’un même exercice la juridiction et l’ordre est une nécessité non pas métaphysique mais seulement morale. Si on ne doit pas les séparer en tout sujet, ces deux pouvoirs sont essentiellement distincts et séparables, et ils peuvent être séparés en quelques sujets . Il est donc possible, selon le droit divin et théologiquement parlant, de consacrer un évêque pour lui transmettre le seul pouvoir d’ordre, sans l’investir d’un pouvoir de juridiction. De fait, Notre Seigneur a d’abord consacré ses apôtres évêques, le soir du Jeudi Saint, avant de les investir de leur juridiction, au lendemain de sa résurrection.
17. Que réclame alors le droit divin, au niveau de la communication du double pouvoir épiscopal ? Ce qui est d’abord et avant tout de droit divin est précisément l’être de la Papauté tel qu’il se trouve, comme dans son sujet unique, chez l’évêque de Rome. Autrement dit, il est de droit divin que seul l’évêque de Rome possède le pouvoir ordinaire de suprême et universelle juridiction sur l’Eglise du Christ, et qu’il le possède en tant qu’il est le vicaire du Christ. Ce pouvoir ordinaire est donc uniment et identiquement celui du Christ et celui du Pape, évêque de Rome. Il résulte de cela que, toujours de ce point de vue de l’être de la Papauté, il est de droit divin que, dans l’Eglise du Christ, tout autre pouvoir ordinaire de juridiction est subordonné à celui du Pape du point de vue précis de la cause formelle, et au sens où ce pouvoir de juridiction est, dans son essence même, une participation de celui du Pape. Il en résulte aussi d’un autre point de vue, qui est celui de la cause efficiente et de l’arrivée à l’être de ce pouvoir chez celui que le reçoit, que seul le Pape peut communiquer cette juridiction à un autre que lui, dans certaines limites, puisqu’il s’agit de communiquer son propre pouvoir, identiquement et uniment pouvoir du Christ et de son vicaire. Cette résultante signifie qu’il est de droit divin que la communication de la juridiction ordinaire doit se faire par le Pape. Communiquer cette juridiction à l’encontre de la volonté du Pape, c’est aller à l’encontre du droit divin, et c’est s’arroger une prérogative qui, en vertu de ce même droit, appartient au Pape et à lui seul. C’est donc faire schisme, le schisme consistant à s’arroger le privilège du Pape.
18. En revanche, ce n’est pas le droit divin qui fait dépendre la licéité d’une consécration épiscopale (c’est à dire la communication du pouvoir d’ordre) d’un mandat du Pape. Certes oui, cette licéité dépend de ce mandat, mais les canonistes précisent qu’il n’y a pas là un droit divin. Le Père Félix Cappello, par exemple, dit dans son Tractatus canonico-moralis de sacramentis, vol. IV « De sacra ordinatione », Marietti, 3e édition, 1951, au n° 320, que cette exigence d’un mandat pontifical n’est pas apparue avant le onzième siècle et qu’elle vaut seulement pour l’Eglise latine. Jusqu’à cette date, le Pape ne s’était pas encore réservé la consécration épiscopale. Cette réserve ne s’est généralisée que progressivement, à cause d’abus de la part des métropolitains. Ce sont donc uniquement des circonstances historiques qui ont motivé cette mesure finalement entérinée par le droit canonique. Par conséquent, si la consécration épiscopale dépend d’une autorisation spéciale du Pape, c’est au titre d’un simple droit ecclésiastique. Et consacrer un évêque sans cette autorisation et à l’encontre de la volonté, même explicite, du Pape constitue à l’ordinaire un acte de désobéissance, grave certes, non un schisme. La transmission du pouvoir d’ordre est celle d’un pouvoir qui est le pouvoir même du Christ, pouvoir également départi à tout évêque, celui de Rome compris, et transmissible par tout évêque agissant dans le cadre d’un rite valide comme l’instrument du Christ, le Pape, évêque de Rome, n’ayant à cet égard rien de plus que tout autre évêque.
Le bien-fondé de l’attitude de la Fraternité Saint Pie X.
19. Nous pouvons dès lors, pour répondre à l’argumentation fausse des responsables de la mouvance Ecclesia Dei, soutenir le raisonnement suivant :
Prémisse majeure - Tout acte qui, n’allant pas à l’encontre du droit divin, va à l’encontre du droit humain pour sauvegarder le bien commun gravement compromis par la carence de l’autorité est un acte rendu licite par l’état de nécessité.
Prémisse mineure - Or, consacrer des évêques à l’encontre de la volonté explicite d’un Pape moderniste qui s’oppose à la Tradition de l’Eglise équivaut à un tel acte.
Conclusion - C’est pourquoi, la consécration d’évêques accomplie à l’encontre d’un Pape moderniste s’opposant à la Tradition de l’Eglise est rendue licite par l’état de nécessité.
20. La prémisse majeure donne la définition de l’acte accompli en vertu de l’état de nécessité. La prémisse mineure vérifie que la consécration épiscopale envisagée par la Fraternité Saint Pie X correspond à cette définition, à partir des précisions que nous avons indiquées plus haut. La conclusion suit.
21 On objectera à cela que la consécration épiscopale communique uniment le pouvoir d’ordre et le pouvoir de juridiction et que, par conséquent, telle qu’accomplie contre la volonté du Pape, elle va à l’encontre du droit divin et représente un schisme. Nous nions le présupposé de l’objectant, qui est l’enseignement faux du numéro 21 de la constitution Lumen gentium de Vatican II, faux parce que contraire à toute la discipline et à la doctrine de l’Eglise, ainsi qu’en ont témoigné les Pères du Coetus qui se sont opposés à ce texte au moment du Concile.
22. On objectera encore que la consécration épiscopale accomplie contre la volonté du Pape est un acte intrinsèquement mauvais. Nous nions, là encore ce présupposé, car il est contradictoire. Un acte intrinsèquement mauvais est un acte mauvais en raison de son objet même, indépendamment de tout précepte émané du législateur. Il se distingue comme tel de l’acte extrinsèquement mauvais, qui est tel en raison d’un précepte . Retirer la vie à un innocent est un acte intrinsèquement mauvais, tandis que manger de la viande le vendredi est un acte mauvais en raison de la loi de l’Eglise. La consécration épiscopale accomplie sans le mandat pontifical n’est mauvaise qu’en raison du droit ecclésiastique, et non pas intrinsèquement, et si elle est accomplie contre la volonté du Pape, il ne s’agit pas ici de la volonté spécifique du Pape pris comme tel, laquelle porte sur les moyens requis au bien commun de l’Eglise ; il s’agit de la volonté désordonnée de la personne humaine de celui qui est Pape et qui abuse de sa fonction, au détriment du bien commun de l’Eglise. Car la personne Pape, dit Cajetan dans un texte demeuré célèbre, peut refuser d’accomplir ce qui est exigé par l’office du Pape, alors qu’elle est pourtant liée par les lois que lui dictent sa charge .
23. En définitive, tout dépend surtout de la deuxième prémisse : la volonté du Pape actuel est-elle celle d’un moderniste qui s’oppose à la Tradition de l’Eglise ?... Pour répondre à cette question, il faut avoir de bons yeux, les yeux de la foi, les yeux de l’Eglise enseignée depuis vingt siècles.
Abbé Jean-Michel G